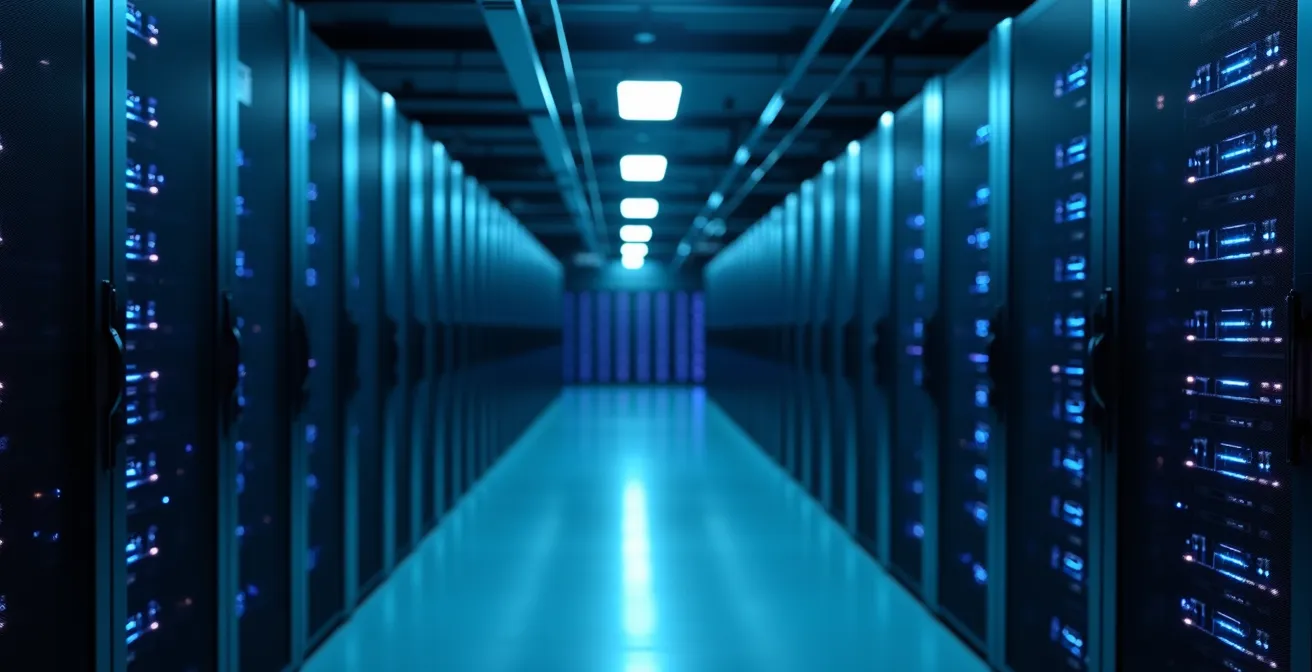
Le « Cloud » n’est pas un simple disque dur en ligne, mais un écosystème géo-stratégique complexe où chaque choix technique a des implications concrètes.
- Le lieu où vos données sont stockées (UE vs USA) détermine le droit qui s’applique et donc le niveau de protection de votre vie privée.
- Le coût réel du stockage inclut souvent des frais de sortie de données (egress fees) qui peuvent représenter une part majeure de la facture et créer un verrouillage.
Recommandation : Analyser la localisation des serveurs et les politiques de frais de sortie est aussi crucial que de comparer les prix au Go pour faire un choix éclairé.
Lorsque vous sauvegardez une photo sur votre service de « Cloud » favori, où va-t-elle réellement ? L’image d’un nuage immatériel, accessible de partout, est une métaphore marketing puissante. Pourtant, derrière cette simplicité se cache une infrastructure physique bien réelle, faite de gigantesques entrepôts de serveurs, de kilomètres de câbles sous-marins et, surtout, de choix architecturaux et géopolitiques complexes. Beaucoup pensent qu’il suffit de comparer le prix au gigaoctet pour choisir son fournisseur, mais c’est ignorer l’essentiel.
La réalité est que le monde du Cloud est un territoire dominé par une poignée d’acteurs, où les lois d’un pays peuvent s’appliquer à vos données même si elles sont stockées dans un autre. Mais si la véritable clé n’était pas le prix du stockage, mais plutôt la compréhension de son architecture ? Et si le choix entre un type de stockage « objet » et « fichier » ou entre un hébergeur américain et européen avait plus d’impact sur votre sécurité et votre budget que vous ne l’imaginiez ? Cet article n’est pas un simple comparatif. C’est une visite guidée dans les coulisses du Cloud, conçue par un architecte. Nous allons démonter les mécanismes, des centres de données physiques aux lignes de code, pour vous donner les clés de compréhension. Vous découvrirez pourquoi tous les stockages ne se valent pas, comment les géants du secteur vous gardent captifs et quelles sont les alternatives souveraines qui émergent pour protéger notre autonomie numérique.
Pour naviguer dans cet univers complexe, nous avons structuré ce guide en plusieurs étapes clés. Chaque section lève le voile sur une facette spécifique du Cloud, vous armant des connaissances nécessaires pour passer du statut d’utilisateur passif à celui d’acteur averti.
Sommaire : Les secrets de l’architecture et de la géopolitique du stockage Cloud
- AWS, Azure, Google Cloud : la guerre des trois géants qui hébergent la quasi-totalité de l’internet mondial
- Stockage objet vs fichier : pourquoi les développeurs et les services de streaming n’utilisent pas la même chose que vous
- Vos données sont-elles en Europe ou aux États-Unis ? Une question de droit qui change tout pour votre vie privée
- Le piège du stockage Cloud pas cher : les frais de sortie de données qui peuvent faire exploser votre facture
- Peut-on se passer des GAFAM ? L’état des lieux des offres de Cloud souverain en Europe
- Vos fichiers dans le Cloud sont-ils vraiment à l’abri des regards ? Comprendre le chiffrement de bout en bout
- Votre connexion internet est-elle prête pour votre croissance ? Le calcul simple pour anticiper vos besoins futurs
- Le Cloud n’est pas qu’un disque dur en ligne : c’est le coffre-fort de votre vie numérique
AWS, Azure, Google Cloud : la guerre des trois géants qui hébergent la quasi-totalité de l’internet mondial
Bienvenue dans la salle des machines de l’internet moderne. Contrairement à l’idée d’un réseau décentralisé, une part immense de ce que nous consultons en ligne (services de streaming, applications mobiles, sites d’entreprise) repose sur l’infrastructure de trois entreprises américaines : Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud. Ce ne sont pas juste des hébergeurs ; ce sont des « hyperscalers », des constructeurs d’empires numériques dont la puissance d’investissement est colossale. Pour vous donner un ordre de grandeur, ils ont investi près de 800 milliards de dollars dans leurs infrastructures depuis 2010.
Cette concentration a une conséquence directe sur le marché. En France comme en Europe, la domination est écrasante : selon les données officielles, les géants américains AWS, Azure et Google Cloud dominent entre 70% et 80% du marché. Cette situation crée une dépendance technologique et économique massive. Face à cette hégémonie, des acteurs européens comme le français OVHcloud tentent de proposer une alternative axée sur la souveraineté. Comme le souligne Benjamin Revcolevschi, son directeur général, cette stratégie n’est pas nouvelle :
La souveraineté, c’est un positionnement stratégique qu’OVH Cloud a pris depuis 20 ans. Et, quelque part, l’histoire nous donne raison aujourd’hui.
– Benjamin Revcolevschi, Directeur général d’OVHcloud, déclaration à l’AFP
Le défi est immense. L’avance technologique et la capacité d’innovation des hyperscalers américains, notamment dans l’intelligence artificielle, les rendent quasi incontournables pour de nombreuses entreprises cherchant la performance à tout prix. Comprendre cette dynamique oligopolistique est le premier pas pour saisir les enjeux qui dépassent la simple technique.
Stockage objet vs fichier : pourquoi les développeurs et les services de streaming n’utilisent pas la même chose que vous
Quand vous pensez à stocker un fichier, vous imaginez probablement une arborescence : un document dans un dossier, lui-même dans un autre dossier. C’est le principe du stockage de fichiers (File Storage), hérité de nos ordinateurs personnels. Il est parfait pour organiser des données structurées, comme des documents d’entreprise ou des projets. Chaque fichier a un chemin unique (ex: `C:DocumentsFactures2024facture_janvier.pdf`), ce qui le rend facile à retrouver dans une hiérarchie logique.
Cependant, pour les besoins du web moderne, comme stocker les millions de photos d’un réseau social ou les vidéos d’une plateforme de streaming, ce système atteint ses limites. C’est ici qu’intervient le stockage d’objets (Object Storage). Imaginez un immense entrepôt sans étagères, où chaque boîte (l’objet) possède une étiquette unique (un identifiant). Un objet contient non seulement la donnée brute (l’image, la vidéo), mais aussi des métadonnées descriptives (date de création, type de contenu, droits d’accès). Il n’y a pas de hiérarchie de dossiers ; tout est à plat. L’accès se fait directement via son identifiant, souvent via une simple URL web (HTTP), ce qui est idéal pour une diffusion massive et rapide sur internet.

Cette dichotomie technologique est fondamentale. Les services comme Netflix ou Spotify reposent sur le stockage objet pour sa scalabilité quasi infinie et sa résilience. Chaque fichier est répliqué plusieurs fois sur différents serveurs, garantissant sa disponibilité même en cas de panne. En revanche, un cabinet d’avocats préférera un stockage fichier pour son organisation stricte et sa gestion fine des permissions au niveau des dossiers. Le choix n’est donc pas anodin, il est dicté par l’usage.
Vos données sont-elles en Europe ou aux États-Unis ? Une question de droit qui change tout pour votre vie privée
Vous avez choisi un fournisseur qui vous garantit que vos données sont stockées dans un datacenter en France. Vous êtes donc protégé par le RGPD et à l’abri des regards indiscrets, n’est-ce pas ? Pas si simple. Si ce fournisseur est une entreprise de droit américain (comme AWS, Azure ou Google), vos données restent soumises au Cloud Act. Cette loi américaine permet aux autorités judiciaires des États-Unis d’exiger l’accès à des données stockées par ces entreprises, où qu’elles se trouvent dans le monde, y compris en Europe.
Cette « extraterritorialité » du droit américain est au cœur de la bataille pour la souveraineté numérique. L’exemple du Health Data Hub français est emblématique. Le choix initial d’héberger les données de santé de millions de Français sur la plateforme Azure de Microsoft a soulevé une vive polémique, précisément à cause de cette exposition au Cloud Act.
Étude de cas : L’échec du Health Data Hub sur Azure
Malgré les controverses, Microsoft a été choisi pour héberger les données médicales des Français début 2024. Cette décision a illustré la tension entre le besoin d’une technologie avancée et la garantie de souveraineté. Le fait que les données soient soumises au Cloud Act américain, permettant un accès potentiel des autorités US même pour des données stockées en France, a été un électrochoc. Cet épisode a considérablement accéléré la prise de conscience et le développement d’alternatives souveraines crédibles en France.
Pour contrer cette dépendance, la France investit dans la recherche. Dans le cadre du plan France 2030, le PEPR Cloud, codirigé par l’Inria et le CEA, bénéficie d’un financement de 56 millions d’euros sur 7 ans pour développer des technologies cloud de nouvelle génération. Le choix d’un hébergeur n’est donc pas seulement technique, il est politique. Il s’agit de décider sous quelle juridiction vous placez vos informations les plus sensibles.
Le piège du stockage Cloud pas cher : les frais de sortie de données qui peuvent faire exploser votre facture
Lorsque vous comparez les offres Cloud, votre regard est attiré par le prix de stockage au gigaoctet, souvent très bas. C’est la vitrine. Mais le véritable coût se cache souvent dans l’arrière-boutique : les frais de sortie (ou « egress fees »). Ces frais vous sont facturés chaque fois que vous « sortez » des données de l’infrastructure du fournisseur. Cela inclut le simple affichage d’une image sur votre site web à un internaute, la restauration d’une sauvegarde, ou pire, la migration de toutes vos données vers un autre fournisseur.
Cette pratique est une composante essentielle du modèle économique des hyperscalers. Elle crée une friction financière qui décourage le changement de fournisseur, un phénomène connu sous le nom de verrouillage fournisseur (vendor lock-in). L’ampleur des marges réalisées sur ces frais est vertigineuse. Selon David Friend, PDG de Wasabi Technologies, certains clients voient leur facture cloud constituée à 50% de frais de sortie. Une étude a même révélé un chiffre encore plus choquant : selon une étude de Cloudflare, la marge réalisée par AWS sur les frais de sortie est estimée à près de 8000% par rapport au coût réel de la bande passante.
Heureusement, la réglementation européenne commence à s’attaquer à ce problème. Le récent Data Act vise à faciliter la portabilité des données et a poussé les géants américains à revoir leur politique. Ils proposent désormais la gratuité des frais de sortie, mais sous des conditions très strictes, souvent liées à une migration définitive et à la fermeture complète du compte. C’est une avancée, mais qui reste loin de la gratuité totale pratiquée depuis toujours par des acteurs européens comme OVHcloud ou Scaleway.
| Fournisseur | Avant 2024 | Après Data Act (2024) | Conditions |
|---|---|---|---|
| Google Cloud | Frais standards | Gratuit pour migration | Première suppression – Janvier 2024 |
| AWS | 0,09 $/Go après 100 Go gratuits | Gratuit pour migration définitive | Mars 2024 – Fermeture compte requise |
| Microsoft Azure | 0,087 $/Go après 100 Go gratuits | Crédit équivalent aux frais de sortie (pendant 60 jours) | Mars 2024 – Crédit sur facture |
| OVHcloud / Scaleway | Gratuit | Toujours gratuit | Politique historique maintenue |
L’analyse de l’architecture de coût complète, incluant le stockage, le trafic sortant et les opérations, est donc impérative avant de s’engager.
Peut-on se passer des GAFAM ? L’état des lieux des offres de Cloud souverain en Europe
Face à la domination des hyperscalers américains et aux enjeux de souveraineté posés par le Cloud Act, l’Europe et la France cherchent à construire une alternative crédible. L’idée d’un « Cloud souverain » n’est pas de recréer de zéro un concurrent à AWS, mais de proposer des solutions garantissant que les données hébergées en Europe sont soumises exclusivement au droit européen, à l’abri des lois extraterritoriales. La volonté politique est claire : le gouvernement français s’est fixé comme objectif de doubler la part de marché des acteurs français du cloud d’ici 2030.
Plusieurs approches coexistent. D’une part, des acteurs « souverains par conception » comme OVHcloud ou Scaleway, qui maîtrisent toute leur chaîne technologique, de la construction des serveurs à la couche logicielle. D’autre part, des solutions hybrides émergent, cherchant à combiner le meilleur des deux mondes : la richesse fonctionnelle des technologies américaines et les garanties juridiques européennes. C’est le cas du projet « Bleu ».
Étude de cas : Le partenariat « Cloud de Confiance » de Bleu
Après l’échec d’un premier projet de cloud souverain, Orange s’est associé avec Capgemini et Microsoft pour créer « Bleu ». Cette offre, qualifiée de « Cloud de Confiance » et lancée en 2024, est un compromis hybride. Elle permet aux entreprises françaises de bénéficier de l’architecture et des services innovants de Microsoft Azure, mais opérés par une entité de droit français (Bleu) sur des serveurs situés en France. Ce modèle promet une immunité technique et légale au Cloud Act, garantissant que Microsoft n’a aucun accès aux données des clients. Il illustre la recherche d’un équilibre pragmatique entre l’accès aux meilleures technologies et la protection de la souveraineté.
Se passer totalement des GAFAM est aujourd’hui difficile, voire impossible pour certains cas d’usage très spécifiques comme l’IA à très grande échelle. Cependant, pour une large majorité des besoins des entreprises et des administrations, des offres souveraines et de confiance, robustes et compétitives, existent. La clé est une analyse fine des risques et des besoins pour segmenter les données : les plus critiques sur un cloud souverain, les moins sensibles pouvant éventuellement être hébergées ailleurs.
Vos fichiers dans le Cloud sont-ils vraiment à l’abri des regards ? Comprendre le chiffrement de bout en bout
La sécurité dans le Cloud repose sur deux piliers : la sécurité physique et la sécurité logique. La sécurité physique concerne la protection des data centers eux-mêmes. Imaginez des forteresses modernes : clôtures, gardes, caméras, contrôle d’accès biométrique… Tout est fait pour empêcher un accès non autorisé aux serveurs où sont stockées vos données.

Mais la menace la plus probable n’est pas physique, elle est numérique. C’est là qu’intervient la sécurité logique, et notamment le chiffrement. Vos données peuvent être chiffrées à deux moments : « en transit » (lorsqu’elles voyagent entre votre appareil et le serveur) et « au repos » (lorsqu’elles sont stockées sur les disques durs du fournisseur). La plupart des grands fournisseurs assurent ces deux niveaux de chiffrement. Cependant, cela signifie que le fournisseur, qui détient les clés de chiffrement, peut techniquement accéder à vos données (par exemple, pour répondre à une injonction légale).
Pour une confidentialité maximale, il faut viser le chiffrement de bout en bout (E2EE). Dans ce scénario, les données sont chiffrées sur votre appareil avant même d’être envoyées au Cloud, et seule vous possédez la clé pour les déchiffrer. Le fournisseur ne stocke qu’un bloc de données illisible pour lui. C’est le plus haut niveau de sécurité, mais il a une contrepartie : si vous perdez votre clé de chiffrement, personne, pas même le fournisseur, ne pourra vous aider à récupérer vos données. Pour les données les plus sensibles, il est essentiel de vérifier les garanties offertes par l’hébergeur.
Points clés à vérifier pour la sécurité de votre hébergeur Cloud
- Certifications : Le fournisseur possède-t-il des certifications reconnues comme ISO 27001 (sécurité de l’information), HDS (Hébergeur de Données de Santé) ou la qualification SecNumCloud de l’ANSSI ?
- Localisation : Où sont situés physiquement les datacenters principaux et ceux de sauvegarde ?
- Chiffrement : Quelles sont les garanties de chiffrement des données au repos et en transit ? Le chiffrement de bout en bout est-il une option ?
- Procédures : Quelles sont les procédures de destruction sécurisée des disques en fin de vie (broyage physique) et existe-t-il un Plan de Reprise d’Activité (PRA) documenté ?
Votre connexion internet est-elle prête pour votre croissance ? Le calcul simple pour anticiper vos besoins futurs
L’adoption massive du Cloud a un effet de bord souvent sous-estimé : elle met une pression considérable sur votre connexion internet, qui devient la porte d’entrée (et de sortie) de votre système d’information. Une bande passante insuffisante peut transformer les promesses d’agilité du Cloud en une expérience lente et frustrante. Imaginez devoir restaurer une sauvegarde critique après un incident : le temps nécessaire dépend directement de votre débit. À titre d’exemple, pour restaurer 1 To de données depuis le cloud, il faut compter 22 heures avec une connexion ADSL contre seulement 2h15 avec une fibre à 1 Gbps.
Anticiper vos besoins en bande passante est donc une étape stratégique. Il ne s’agit pas de prendre « le plus gros tuyau » possible, mais de calculer au plus juste pour ne pas surpayer une capacité inutile tout en prévoyant les pics d’activité et la croissance future de votre entreprise. Une formule simple peut vous aider à estimer vos besoins, notamment pour une PME.
Plan d’action : Calculez votre besoin en bande passante pour le Cloud
- Évaluez le besoin de base : Multipliez le nombre d’employés travaillant simultanément sur le réseau par un besoin moyen de 10 Mbit/s par personne.
- Ajoutez les usages intensifs : Complétez avec les besoins spécifiques, comme +25 Mbit/s pour chaque salle de visioconférence en haute définition utilisée régulièrement.
- Intégrez les sauvegardes : Calculez le débit requis pour vos sauvegardes : (Volume quotidien en Go × 8) / (Durée de la fenêtre de sauvegarde en heures) = Mbit/s nécessaires.
- Appliquez une marge de sécurité : Multipliez le résultat total par un coefficient de sécurité de 1,5 pour absorber les pics d’utilisation inattendus.
- Prenez une décision éclairée : Si votre besoin calculé dépasse régulièrement les 100 Mbit/s, l’investissement dans une connexion fibre optique dédiée n’est plus une option, mais une nécessité pour une utilisation fluide du Cloud.
Ce calcul vous donne une base solide pour discuter avec les fournisseurs d’accès internet et choisir une offre qui supportera non seulement vos opérations actuelles mais aussi votre croissance à venir, garantissant que votre « autoroute de l’information » ne se transforme pas en chemin de terre.
À retenir
- La domination d’AWS, Azure et Google Cloud (70-80% du marché français) crée une forte dépendance technologique et juridique (Cloud Act).
- Le coût réel du Cloud doit inclure les frais de sortie (« egress fees »), qui peuvent être exorbitants et constituent une stratégie de verrouillage.
- Les alternatives de Cloud souverain (OVHcloud, Scaleway) ou « de confiance » (Bleu) offrent des garanties juridiques cruciales pour les données sensibles.
Le Cloud n’est pas qu’un disque dur en ligne : c’est le coffre-fort de votre vie numérique
Au terme de cette visite dans les coulisses, l’image du Cloud comme simple « disque dur en ligne » apparaît pour ce qu’elle est : une simplification extrême. Nous avons vu que derrière chaque gigaoctet stocké se cachent des choix stratégiques majeurs. Le choix du type de stockage (objet ou fichier) conditionne la performance de vos applications. La localisation géographique des serveurs n’est pas un détail, mais un acte qui place vos données sous l’égide de lois américaines ou européennes, avec des conséquences drastiques pour votre vie privée. L’architecture de coût, enfin, est bien plus complexe que le prix affiché et peut cacher des pièges comme les frais de sortie.
La dépendance envers une poignée d’acteurs est un risque stratégique majeur, comme le rappelait l’ancienne ministre du Numérique Clara Chappaz. Face à cela, une approche mature ne consiste pas à rejeter en bloc les technologies américaines, mais à adopter une stratégie multi-cloud intelligente. Il s’agit de répartir les risques et d’optimiser les coûts en utilisant le bon fournisseur pour le bon usage.
Exemple de stratégie multi-cloud pour une ETI française
Une entreprise de taille intermédiaire peut parfaitement utiliser un hébergeur français comme OVHcloud pour ses données les plus critiques (données clients, R&D, comptabilité) afin de garantir la conformité RGPD et l’immunité totale au Cloud Act. Parallèlement, elle peut recourir à la puissance de calcul d’AWS ou d’Azure pour des besoins ponctuels et non sensibles, comme l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle sur des données anonymisées. Cette approche multi-cloud permet de réduire la dépendance, de maîtriser les coûts (les acteurs français étant souvent plus compétitifs sur le rapport prix/performance pour le stockage et la bande passante) et de garantir la souveraineté des actifs numériques les plus précieux.
Le Cloud est donc bien plus qu’un service technique ; c’est le coffre-fort de votre vie numérique personnelle et professionnelle. En comprendre les mécanismes, les serrures et les contrats qui le régissent est devenu une compétence essentielle pour tout citoyen et toute entreprise du 21e siècle.
Maintenant que vous disposez de cette grille de lecture, l’étape suivante consiste à l’appliquer. Évaluez dès maintenant vos propres usages du Cloud, questionnez vos fournisseurs sur leur politique de frais de sortie et la localisation réelle de vos données. Devenir un acteur éclairé de votre souveraineté numérique commence aujourd’hui.